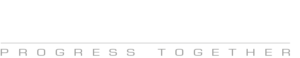Quoi de mieux que de vouloir se mesurer aux meilleurs pour progresser ? C’est exactement ce que visent les sociétés qui disent pratiquer le benchmarking. Mais comment le faire intelligemment ?
Au départ, il s’agit de quantifier
Commençons par rappeler ce que cet anglicisme recouvre. « Benchmark » désigne en anglais une empreinte faite dans la pierre par les géomètres pour se repérer. Pour une entreprise, il s’agit d’une démarche d’observation et d’analyse des pratiques et des performances des autres entreprises. Le terme garde de ses racines techniques une notion de précision et de mesure. Il ne s’accommode pas d’une vague comparaison entre pratiques : le benchmarking doit s’ancrer dans le quantitatif en définissant au préalable des paramètres clefs. Pour les Achats, la pratique la plus immédiate consiste à comparer avec ses pairs les conditions d’obtention de biens ou services similaires. Quand on élargit l’exercice à l’ensemble de la fonction achats, le benchmarking permet d’estimer par comparaison son efficacité (montant des économies réalisées) et son efficience (niveau de ressources mobilisé par la fonction).
Ne pas se limiter aux chiffres
La pratique quantitative me semble toutefois toucher rapidement ses limites parce que les chiffres recouvrent des réalités très différentes d’une organisation à une autre. Si une direction générale cherche à benchmarker son siège, que peut-elle faire du ratio du nombre de postes sur chiffre d’affaires sans une analyse approfondie des rôles respectifs des fonctions du siège et de l’organisation des groupes ?
De même dans les Achats, est-il pertinent de comparer le montant de la dépense par acheteur entre entreprises ? Peut-être, mais à la seule condition de regarder minutieusement ce qu’on appelle acheteur dans l’une et l’autre entreprise, de mesurer les couvertures achats respectives, d’étudier la nature des produits achetés, d’évaluer le travail réalisé par les acheteurs sur le cahier des charges, de comprendre le besoin de recherche de nouvelles sources, d’intégrer les contextes juridiques de l’achat (public – privé par exemple) etc. Je ne vois pas beaucoup d’études de benchmarking s’embarrasser de ce niveau d’information pourtant indispensable pour donner un sens aux chiffres.
Au fond, comment interpréter que le coût d’une fonction achats se monte à 0,5 % du chiffre d’affaires dans une entreprise et à 1 % chez son concurrent ? Que, dans la première, la fonction est beaucoup plus efficiente ? Ou qu’au contraire la fonction achats y est sous-dimensionnée ?
Se comparer intelligemment
La vérité est qu’à mesure que le travail des Achats se complexifie, il s’enrichit par l’interaction tant avec les utilisateurs qu’avec les fournisseurs, il est virtuellement impossible de se fier aux seules données quantitatives. Elles donnent lieu à interprétation et sont d’autant plus dangereuses quand elles ont la caution d’un grand nom du conseil. En définitives, elles ne me paraissent pas suffisantes pour prendre des décisions structurantes.
Le benchmarking est-il donc mort ? Certainement pas ! Il s’agit juste de l’adapter à l’évolution des Achats. La fonction devient plus interactive, plus commerciale, plus ouverte aux innovations : le benchmarking doit évoluer dans le même sens et adopter une approche bien plus globale qu’avant. Il me semble plus riche de prendre le temps de rencontrer ses pairs et de comprendre d’eux le contexte, la réalité des activités, la nature des performances autant que les chiffres. Il ne s’agit pas de s’en affranchir complètement – seulement de les compléter intelligemment. Rien ne peut se substituer au dialogue direct entre praticiens.
Acheter est d’abord une activité commerciale. Rencontrer aussi souvent que possible ses fournisseurs et ses utilisateurs, établir des ponts entre eux, constitue le cœur battant des Achats d’aujourd’hui. Rencontrer ses pairs de sociétés similaires procède du même principe et fait partie d’une démarche enrichissante d’amélioration continue